Histoires vécue / Storie vissute
Manuscrit Blanc
Si j'ai bonne mémoire

Elvire Emma Blanc-Pélerin
31/08/1922 - 06/01/2019
Beaulard (Italie) - Antsirabe (Madagascar)
Avec Elisabetta et Andreina, dans l'hiver 1937-38, tous les matins sauf le samedi et le dimanche, nous allions à Bardonnèche éplucher les oranges. Une entreprise de Paris avait ouvert un grand local près de la gare et toutes les jeunes filles et jeunes femmes des environs étaient embauchées pour éplucher des oranges. Elles arrivaient par wagons entiers de Sicile et nous devions en prélever le zeste qui était destiné à faire de la liqueur (ou du parfum ?). Le local était très grand, nous étions toutes debout, par rangées les unes derrière les autres, et rien pour s'appuyer. Le travail n'était pas bien compliqué. Avec une petite poignée qui faisait tourner l'orange, le couteau courbe appuyait contre le fruit. Il fallait régler l'épaisseur de coupe de façon que le couteau coupe juste sous la peau, sans entamer le fruit.
Ce qui était le plus pénible, c'était de rester droite toute la journée, sans appui. Les oranges arrivaient par trains de marchandises pleins ; de nombreux hommes transportaient les cageots toute la journée. Quand il neigeait toute la nuit, il fallait se lever bien plus tôt. Nous nous mettions des bandes pour nous protéger les jambes, nous n'avions pas de pantalons, ce n'était pas la coutume. Nous portions nos vélos sur l'épaule et nous partions à pied jusqu'à ce que nous rencontrions le chasse-neige. Là, nous pouvions prendre le vélo et filer jusqu'au travail. Le soir, ce n'était pas la neige qui nous gênait, c'était les plaques de verglas sur lesquelles il ne fallait pas glisser. Je ne me rappelle pas combien on était payées, sûrement pas grand-chose. A midi, on apportait notre repas qu'on faisait chauffer sur le poêle chez une dame très gentille qui nous accueillait à Bardonnèche.
Les journées étaient longues. Nous commencions à sept heures le matin, c'était nuit, et le soir, quand on sortait, c'était nuit aussi ! Notre patronne, une Parisienne, parlait l'italien avec un fort accent français. C'était une belle femme, grande et sous les réverbères, le matin, ses cheveux avaient des reflets bleus. Je ne sais pas pourquoi,
En octobre 1938, ma sœur Eglantine et son mari ont acheté un café à Modane. Elle a demandé à mes parents de me laisser aller chez elle pour l'aider. J'y suis restée quatre ans. En 1942, mon frère Arturo nous a donné rendez-vous au col du Rho, un sommet au-dessus de Bardonnèche. Nous y sommes montés, ma sœur Anna et notre neveu Max, le fils de ma sœur Eglantine, alors âgé de six ans. Je ne connaissais pas le chemin. Un client du café nous avait bien dit où passer, mais en montagne, les sentiers et les chemins sont nombreux et la route était longue jusqu'au fameux col. Le temps était beau et nous avons bien trouvé notre frère qui nous attendait avec des militaires, son fusil de chasseur à l'épaule. Il nous avait apporté des pêches d'Italie, grosses comme nous n'en avions jamais vu. Et bonnes ! Il nous a apporté aussi de bonnes nouvelles de notre famille, nous avons ainsi passé quelques heures ensemble heureux.

Anna, Max et moi
A Modane, passaient tous les cheminots italiens, tous les douaniers aussi. Nous étions les seuls à faire le vrai café expresso italien. La machine était neuve, elle venait de Milan. Les prédécesseurs, propriétaires du café, venaient de l'acheter. Leur fille unique allait se marier à Milan et les deux parents avaient peur de rester seuls, surtout qu'il y avait le danger de la guerre et les italiens ne se sentaient pas en sécurité à Modane.
La guerre
En effet, la guerre a commencé en septembre 1939. Mussolini s'est allié avec Hitler, deux fous ensemble ! Le 10 juin 1940, Mussolini entre en guerre contre la France. Il y a eu « il sfallamento » l'exode, de tous les pays
La laiterie
Tout marchait bien au café, et puis les fonctionnaires italiens ne sont plus venus à Modane. Petit à petit, tout devenait plus difficile, très peu de charbon pour se chauffer, les tickets pour tout, il y avait beaucoup moins de monde. Alors, je suis partie à Chambéry chez Yvonne, la belle-sœur d'Eglantine, pour apprendre la couture. Yvonne était très bonne couturière, elle avait beaucoup de travail. Il y avait les tickets pour tout, et très peu pour les textiles. Les clientes fortunées avaient les grandes robes de leurs mères et grand-mères pour faire des robes pour les filles, et des manteaux dans les grandes capes des aïeuls, des anciens officiers, des anciens marins, etc.
En très peu de temps, j'ai appris les bons gestes de première nécessité pour la couture, j'étais logée mais pas d'argent. Pour en avoir un peu, je suis rentrée chez les Laurent, qui tenaient un magasin de beurre, œufs, fromages, laiterie, 77 place Saint-Léger à Chambéry. Là aussi, il fallait les tickets pour tout et pour tous. Mais je m'y suis bien habituée. Il y avait beaucoup de travail, les patrons étaient gentils et je
Un jour, j'ai eu la surprise de voir deux soldats italiens qui admiraient ma pyramide de boîtes. Je suis sortie, et oui ! c'était Severino Mounier et Filiberto Garnier. Ils ont été surpris eux aussi de me trouver là. Nous nous sommes embrassés, ma patronne était choquée. « Oh Elvire, vous embrassez les soldats italiens ? ». « Mais Madame, ce sont deux camarades de classe, je les connais depuis toujours ! ». Elle ne m'a plus rien dit. Ainsi tous les dimanches après-midis, nous allions nous promener ensemble. La maman d'Yvonne la couturière était malade. J'allais toutes les semaines les voir. Depuis le commencement de la guerre en France, on ne trouvait plus un citron, ni une orange. J'ai demandé à mes deux amis s'ils pouvaient en avoir et ils m'en ont apporté un bon kilo. Comme la grand-mère malade les a appréciés !
La pénicilline
Severino était fiancé avec Letizia, une amie du Château, camarade d'école aussi. Elle est venue dire à ma maman que nous nous étions trouvés à Chambéry. Elle a trouvé ma maman malade, disant qu'elle avait besoin de moi. J'ai aussitôt quitté mon emploi pour venir à Beaulard.
Maman était bien malade en effet. Heureusement, il y avait à l'Hôtel Vittoria, une clinique transférée de Turin à Beaulard pour échapper aux bombardements, la clinique Pina Pintor. Un jeune médecin, le Docteur Briccarello et une religieuse,
Les Allemands
Un jour, à Beaulard, nous avons vu les soldats italiens quitter leur campement et la caserne du Colomion. Pour quelle raison ? Nous n'avions ni radio, ni journaux, nous n'étions au courant de rien !
Comme tout le monde à Beaulard allait au Colomion pour récupérer quelque chose, avec ma sœur Delphine, nous y sommes allées. Dans une tente, par terre, j'ai trouvé un dictionnaire français-italien. Je l'ai toujours ! D'autres avaient déjà pillé les tentes. Nous avons récupéré des tentes neuves pour le foin, et Delphine un meuble neuf très bien avec plusieurs tiroirs. Mais la guerre, elle était finie ? Et Mussolini, où était-il ? Peut-être une semaine après, les soldats allemands sont arrivés.
Arturo
Avant que les soldats italiens ne quittent les casernes, mon frère Arturo, qui était réserviste, a reçu une convocation pour se présenter à la caserne de Turin. A Charlina logeait un officier avec sa famille. Mon père lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour que mon frère reste à la maison. Il lui a répondu : « Il doit se présenter et je ferai tout mon possible ». Mais rien n'a été fait. Deux jours après, comme il n'était pas revenu, mon père m'a demandé d'aller voir à la caserne ce qu'il faisait. A la porte de la caserne, il y avait un soldat, avec une table et un cahier. Tous ceux qui voulaient voir un soldat devait signer le cahier. Moi j'ai écrit que je voulais voir le soldat Blanc
En fait, à la caserne de Turin, j'avais bien vu Arturo habillé en militaire. Mais nous nous sommes assis sur un banc dans une cour ouverte entre les deux casernes, la caserne militaire et celle de la gendarmerie. Il m'a dit qu'il ne voulait pas aller en Allemagne. Vers seize heures, il irait se changer dans les WC, remettrait ses vêtements civils et il sortirait du côté gendarmerie. Il allait tenter le tout pour le tout. Avec Delphine, nous devions passer à seize heures devant la caserne de gendarmerie. Si tout allait bien, nous irions ensemble à la gare ferroviaire, s'ils l'arrêtaient, on verrait bien ! Par le grand portail de la gendarmerie, on voyait de nombreux officiers des deux casernes. Nous avons vu arriver notre frère en civil, il a fait le salut militaire, un officier a répondu à son salut et... personne ne lui a rien demandé. Nous avons fait semblant de ne pas nous connaître, et, après le coin de la rue, nous avons pu respirer. Ouf, quelle joie ! Delphine est retournée à son travail, et nous, nous sommes allés au buffet de la gare, un peu à l'écart, pris une boisson pour attendre l'heure de monter dans le train.
Nous sommes montés dans le wagon à bestiaux, assis sur les bords côté Oulx pour être libres de sauter à la gare de Beaulard. Le wagon était plein de gens assis comme nous sur toute la longueur du wagon, les autres debout appuyés sur la barre, et plein d'autres dans le wagon, assis ou debout. Arrivés entre Charlina et Beaulard, Arturo m'a touché le coude et moi, je me suis mise à crier « Ne me poussez pas, vous allez me faire tomber ! ». Tous les yeux se sont braqués sur moi et personne n'a vu mon frère sauter. De nuit, il est venu se changer, prendre à manger et pris les clés de la grange du Pleynet où il est allé se cacher.
Les couvertures
Mon oncle Baptiste Chalier est le mari de la femme malade au Puys lors de la chute du Docteur Ruffina ayant entraîné sa mort et ce drame. Ma tante avait bien guéri et quelques années plus tard, ils ont pris en gérance un hôtel à Oulx. L'affaire allait bien et ils avaient aussi comme clients, des officiers italiens. Un jour, ces officiers ont reçu tout un chargement de couvertures pour la troupe et, comme les soldats quittaient les casernes et que la guerre était finie pour les italiens, ils ont vendu (ou donné) tout le lot de couvertures à mes oncle et tante. Pour l'hôtel, ils en auraient toujours besoin. Mon oncle a monté le tout dans sa maison du Puys, car dans la grange, il y avait de la place pour les stocker. Mais des voisines, la mère et la fille, les ont vus les décharger. Jalouses ! La fille a écrit une lettre anonyme à la Kommandantur allemande à Turin. Peu après, le Puys a été encerclé, fouillé. Ils ont trouvé les couvertures et tous les hommes ont été emmenés au bureau des Allemands qui se trouvait à Beaulard, entre le passage à niveau et la gare (ils occupaient la maison avec des logements et au rez-de-chaussée la grande salle où l'on dansait avant la guerre). Mon oncle avait été dénoncé comme fournisseur des terroristes.
Un graphologue allemand a trouvé l'auteur de la lettre, c'était une jeune fille et, comme il y en avait une seule au Puys, elle a été inculpée. Elle a fini par avouer après qu'elle ait été interrogée pendant une bonne semaine, mais il a fallu pour ça qu'ils menacent de brûler tout le hameau du Puys. Comme elle était mineure, seize ans à l'époque, elle a fait un mois à la prison d'Oulx, mais quelle honte ! Je n'aurais pas voulu être dans sa peau !
L'été 44
Mon frère était caché au Pleynet, mais quand les vaches sont montées au pâturage, il ne pouvait plus rester car tous les soirs, dans toutes les granges, il y avait une femme qui montait pour s'occuper des vaches, tirer le lait pour le redescendre à Beaulard. Comme il ne devait surtout pas se montrer, il fallait qu'il campe sous une petite toile de tente.
Là où mon père avait fait son apprentissage de boulanger, les patrons avaient un garçon de vingt ans, Maurizio, et ils avaient peur qu'il soit envoyé en Allemagne. Il a pris le maquis avec mon frère, mais du coup, ils étaient deux à nourrir en cachette tout l'été. C'est moi qui faisais tout ! Monter tous les soirs au Pleynet, et après que les femmes soient couchées, je ranimais le feu, je faisais chauffer la soupe, je la leur portais avec le pain, les victuailles et des vêtements propres.et je rapportais les vêtements sales, tout cela en cachette de tout le monde et des Allemands.
Quand les Allemands sont arrivés, ils se sont installés partout où il y avait de la place dans le village. Au four, ils faisaient la cuisine ; à la mairie, ils stockaient du matériel, des chevaux dans les écuries, nous en avions deux dans notre étable.
J'avais la peur au ventre deux fois par jour quand je passais devant les soldats allemands, avec le sac à dos toujours plein, vêtements d'homme, pain, fromage, saucisson, quelques fruits. Si l'un deux avait pris la fantaisie de regarder dans mon sac, j'aurais été fusillée.
Le feu au Château
Les Allemands utilisaient notre écurie pour deux de leurs chevaux. Un jour, Delphine et moi, nous étions dans la grange. Un soldat allemand qui avait le cheval dans notre écurie, arrive et en nous regardant, nous fait le signe de la croix, le geste de sonner les cloches et le geste de pendaison, et nous montre la direction du Château en nous disant : « Terroristes ! ». Vite il s'est sauvé. Nous avions compris qu'ils allaient faire du dégât au Château ! Vite nous sommes parties en coupant par les jardins, devant la fenêtre de Tante Hortense, et à travers les prés, surtout pas par le sentier qui part au Château. Arrivées aux premières maisons, nous avons vu une vieille demoiselle, Mademoiselle Frézé, nous lui avons dit d'alerter tous les hommes que les Allemands allaient venir pour pendre le curé au clocher. Elle nous a ri au nez : « Il n'y a pas de partisans ici ». « Va vite le dire à tout le village, nous, nous allons au Pleynet ». Nous étions donc en train de travailler au Pleynet dans notre pré de la Clea quand arrive le tisserand, le papa de mon amie Emma. Il s'arrête en haut du pré qui est très en pente, il commence à bavarder, puis... il voit de la fumée noire qui vient du Château ! Il dit : « Oh les porcs, ils ont mis le feu au Château ! ». Il est parti à toute vitesse ! Je n'ai jamais vu un homme aussi rapide.
Tout l'été, j'ai fait la corvée pour nourrir Arturo, mon frère et Maurizio.
 |
Mais comme c'était dur pour moi ! Toute la journée, je faisais le travail des champs, et une partie de la nuit, je la passais à rallumer le feu, pour porter à manger aux deux garçons quand il faisait très nuit. Une fois, je ne voyais pas les arbres tellement la nuit était noire. J'ai tapé contre un arbre et le couvercle du « baraquin » a sauté. |
Les journées étaient tellement longues et dures qu'au Pleynet, pour entendre le réveil bien avant que le soleil arrive à la pointe de la Grande Hoche, j'ai utilisé un trou dans le mur disjoint juste à la tête du lit. J'y ai mis un bâton, une ficelle et au bout, le réveil pour qu'il soit juste près de mon oreille, sinon je ne l'entendais pas. Quand le soleil arrivait à la roche, il fallait vite mettre les vaches dehors car le berger les prenait pour aller plus haut en pâture pour la journée. Mais auparavant, il fallait leur
C'était d'autant plus dur d'aller la nuit leur porter à manger qu'ils devaient changer de camp souvent pour ne pas être repérés. Courant août, c'est eux qui venaient à la grange du Pleynet, je n'allais plus rencontrer les arbres dans la nuit. Quand tous étaient couchés, je rallumais le feu, faisais le potage de lait, de semoule, de farine ou de riz et ils mangeaient chaud à l'écurie. Ainsi, je pouvais me coucher plus tôt.
Je me rappellerai toute ma vie de l'été 44, j'ai très peu dormi et pris beaucoup de risques ! Heureusement, maman, après la maladie soignée par la pénicilline, était en bonne santé, c'est elle qui lavait le linge et faisait le dîner à la maison. Mon père avait son travail à Charlina.
L'automne est arrivé, les Allemands étaient toujours là, toujours les mêmes, mais ne s'occupaient pas des paysans. Les chevaux sont partis de l'écurie. Je les vois encore, ils étaient tellement gros, des percherons. Pour passer la porte, ils rampaient comme des chiens qui chassent le gibier. Que notre Bibi était petit à côté ! Les vaches sont revenues au village, Maurizio est retourné chez lui et Arturo est rentré à la maison, mais pendant tout l'hiver, il n'est pas sorti de la maison. Au printemps 1945, les Allemands sont partis sans crier gare.
La veillée d'été
Depuis toujours, du temps de la jeunesse de maman, les veillées s'organisaient aussi l'été aux granges du Pleynet. La tradition est restée avec moi jeune fille et les autres jeunes femmes montées pour traire les vaches. Il y avait Catherine, la mère de Pierre Blanc, la maman de Joséphine Tournour, la fille Odiard, Ermelinda. Mon amie Elena n'avait pas le temps, elle avait trop de bêtes à s'occuper. Toutes arrivaient avec une
Une fois par semaine, nous devions faire le beurre avec le lait de la traite. Tous les deux jours, nous écrémions le lait avec une spatule en bois très fine. La crème était placée dans un grand plat en terre vernissée avec un couvercle bien ajusté, et conservée à la cave bien fraîche. A la fin de la semaine, on versait toute cette crème dans la baratte de bois, la « beurrière » et on la battait jusqu'à ce que le bruit change, cela durait de quarante-cinq minutes à une heure et c'était très pénible. Les particules de beurre s'aggloméraient, petit à petit, le morceau de beurre devenait plus gros. On le prenait dans des mains bien propres, frottées avec du son de blé et rincées à l'eau très froide. Le bloc de beurre était lavé à l'eau plusieurs fois pour bien se conserver et tassé dans un moule en bois. Pour le descendre au village, on l'enveloppait dans de grandes feuilles de gentiane, puis dans un torchon.
Il ne fallait pas nous bercer longtemps le soir. Nous dormions dans des lits garnis de paille souple sur laquelle on étendait de grands draps de chanvre et deux à trois couvertures de la laine de nos moutons. On dort très bien sur la paille !

Notre grange du Pleynet
Dans l'hiver, Sœur Adalgisa nous avait fait faire une pièce de théâtre. Moi, je jouais le rôle de la maman d'Andreina. Pour me vieillir, on m'avait saupoudré les cheveux de farine. A l'église, le curé nous a fait apprendre la messe en latin, la Messe des Anges. Comme c'était beau !
Le retour à Chambérv
A Bardonnèche, un chef de gare que je connaissais depuis Modane, m'a demandé si je pensais retourner en France. Oui, mais quand ? Le tunnel avait sauté ! Il m'a dit « Avant de partir, j'ai mis tous mes meubles à Villarodin chez Mademoiselle Clair. Je voulais vous demander, si vous y alliez, de lui dire que nous sommes tous en vie et que je viendrai reprendre mes meubles dès que possible. ». « Si je peux, oui, mais je ne vous le garantis pas. ».
En octobre 1945, je vois Serafino Allemand de Beaulard à la fontaine. Il me demande si je pensais retourner en France. Oui, mais comment ? « Si tu veux venir, j'y vais mais il faut passer la montagne ». « Oui, dis-moi le jour, je serai prête ». Je crois bien que c'était un samedi matin. Nous prenons la route à pied jusqu'à Bardonnèche où un monsieur et une dame nous attendaient. De là, tous les quatre, nous partons jusqu'à Rochemolles où nous avons couché dans une étable, par terre sur de la paille. Au petit jour, en ouvrant les yeux, j'aperçois une forme dans un lit haut sous lequel se tenaient des moutons. C'était une très vieille personne, homme ou femme, mais surtout le plus impressionnant, c'étaient d'épaisses toiles d'araignées qui pendaient depuis le plafond jusqu'à son crâne. Elle nous regardait en silence ! Pauvre être abandonné ! j'étais très choquée. Au Pleynet, c'est le réveil qui touchait mon crâne, pas les araignées.
Nous reprenons le chemin, un sentier après le barrage de Rochemolles, qui monte, monte, virage après virage, jusqu'au sommet pour attaquer un raidillon rocheux, pas facile.
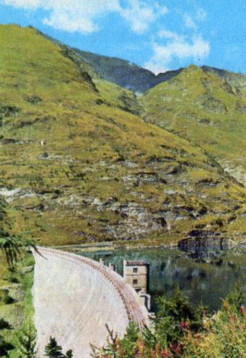 |
Passé ce raidillon, un groupe d'oiseaux gris se sauvent, apeurés par notre présence. Des perdrix ? Nous arrivons au point le plus haut de notre traversée, le Col de la Pelouse à 2802 mètres.
Au dessus du barrage de Rochemolles, on peut apercevoir les virages sans fin jusqu'au sommet |
J'espérais aussi revoir Serafino Allemand mais lui non plus, je ne l'ai jamais revu.
Quand je les ai quittés en octobre 1943, mes patrons de la laiterie, les Laurent, m'avaient dit de revenir le plus vite possible. Je suis revenue en octobre 1945. Avec quelques kilos de riz mais pas de vêtements. Mon patron m'a emmenée à Saint-Jean-de-Maurienne pour signaler mon entrée en France et faire les papiers pour travailler. Nous avons signé un contrat pour six mois, mais il fallait que je retourne à Beaulard pour prendre des vêtements et rassurer mes parents, leur dire que j'avais un contrat de travail. Il a donc fallu que je refasse tout le chemin en sens inverse, Chambéry-Modane, et à Modane, après avoir dormi chez l'oncle Jules et la tante Louise, tellement gentils et habitant Avoriaz, je suis repartie à cinq heures du matin pour rejoindre Beaulard. Il faisait encore bien nuit pour retrouver le chemin du Col de la Pelouse. Je priais Dieu de ne pas me tromper, même si j'avais pris quelques repères en venant. Le passage du raidillon était beaucoup plus difficile en raison d'un bloc de glace qui s'était formé là où la roche n'était qu'humide à l'aller. Enfin j'ai franchi cet obstacle en me cramponnant et en faisant un saut.
| La descente jusqu'au barrage a été bien plus rapide que la montée. A un moment, bien après le barrage, j'ai trouvé un sentier en direction de Beaulard, mais là, quelle surprise, je me suis retrouvée au « Bassin », un grand réservoir qui fournissait l'eau à Bardonnèche. J'ignorais totalement qu'il existait ce bassin. Une équipe d'ouvriers qui y travaillaient ont été très surpris de voir arriver une jeune fille, seule à cet endroit, si haut et si isolé. Je leur ai dit d'où je venais et mon intention d'aller à Beaulard. Ils avaient fini la journée, ils s'apprêtaient à redescendre avec le « carrelin », sorte de plateforme métallique montée sur des roues reliées à une crémaillère qui |  |
Une semaine après, j'ai refait le même chemin en sens inverse, mais mon père m'a accompagnée jusqu'au train Modane-Chambéry.
La laiterie
J'ai donc repris mon travail chez les Laurent, mais en deux ans de guerre, ils avaient bien changé, surtout lui ! Normalement, je devais travailler au magasin, mais il me faisait décharger de gros camions pleins de mottes de beurre de cinq et vingt kilos. Les mottes de vingt kilos, c'étaient des cubes d'environ quarante centimètres de côté, celles de cinq kilos étaient rondes un peu aplaties. C'était un magasin de détail et demi-gros. Une fois par mois, on recevait un gros camion qui transportait aussi les tommes de Savoie. Le camion était plein de caisses hautes d'un mètre cinquante avec une douzaine de tommes dans chaque caisse. Je devais débarrasser le camion au plus vite car il gênait le passage. Je traînais ces caisses dans une cave qui se trouvait au fond d'une cour et je devais placer les tommes sur des étagères montant jusqu'au plafond. Le soir, je n'avais même plus la force de manger. Le beurre, je le rangeais par terre, mais les petits commerçants venaient vite le chercher pour le jour de la distribution : cinquante grammes par personne et par mois ! Les J3, jeunes de quinze à vingt ans, avaient droit à une deuxième distribution dans le mois, variable, je ne me rappelle plus combien, vingt-cinq ou cinquante grammes. La faim était toujours là !
Un jour, une vieille dame est venue au magasin demander à Madame Laurent de lui donner un peu de beurre ou de fromage. « Je n'ai plus rien à manger, que l'eau du robinet et je suis bien malade ! ». « Non Madame, je ne peux pas. Mais où on irait si je donnais à tous ? ». Le lendemain, une voisine de la vieille dame est venue nous dire qu'elle était morte. Morte de faim ! Il y avait des clients, mais je n'ai pu m'empêcher de dire à ma patronne : « Vous pouvez être fière de vous ! ». Je me suis retenue d'ajouter : « avec les mottes entières que vous vendez sans ticket ! ».
Gaby
Du matin à sept heures jusqu'au soir vingt-et-une heures, le travail était dur. J'avais pour m'aider une jeune fille de seize ans, Gaby. Elle était gentille, trop gentille. Sa mère était morte et son père l'avait laissée chez les Laurent pour la garder, prendre soin d'elle comme de leur fille, et en guise de salaire, une tomme par mois pour le père !
Un soir, au souper, Monsieur Laurent était de mauvaise humeur. Il est allé aux toilettes et a trouvé un ticket par terre. Il nous a accusées de lui voler des tickets et voulait savoir laquelle des deux. Je lui ai tenu tête et il m'a menacée d'aller dans la chambre. Je lui ai dit : « Venez ! Venez, on va voir ! ». J'étais tellement furieuse qu'il aurait reçu, et pas des caresses. Il m'a dit : « Vous n'êtes qu'une merdeuse, vous n'avez que des petits sous, moi j'ai des millions, moi ! ». Je lui ai répondu : « Monsieur, je préfère mes petits sous honnêtes à vos millions malhonnêtes ! ». La patronne a réagi : « Oh Elvire, ne parlez pas comme ça à mon mari. ». « Pour vous, c'est votre mari, mais pour moi, ce n'est qu'un mauvais patron ! Il m'a dit : « Vous voulez une gifle ? ». Je l'ai regardé droit dans les yeux, et en levant mon assiette de soupe chaude, je lui ai répondu : « Essayez ! ».
Il a baissé les yeux, le repas s'est fini sans qu'on entende une mouche voler. Il me restait encore un mois à faire, il ne m'a plus jamais adressé la parole. La veille de mon départ, j'ai dit à son épouse que je ne viendrais plus à la fin du mois. Le lendemain, elle m'a pris à part : « Mon mari m'a dit que si vous voulez rester, on vous paiera ce que vous nous demanderez. Non Madame, je vous ai assez vus ! ». Je n'ai plus revu le patron.
J'allais coucher chez Yvonne, la belle-sœur d'Eglantine et quelques jours après mon départ, je passe devant la laiterie. Juste à côté, il y avait un magasin de chaussures dont la patronne venait prendre le lait tous les matins. Elle me dit : « La petite Gaby est chez nous, depuis que vous êtes partie, le « grand » la tapait tellement qu'elle est venue se réfugier chez nous. Je connaissais bien ses parents, je la garde, ici elle est en sécurité ». J'aurais bien voulu l'embrasser, ma petite Gaby, mais elle était sortie faire une course.
L'avalanche
Les premiers jours de février 1961, la neige s'est mise à tomber des jours et des jours sur les montagnes. Une nuit, au-dessus du village de Rochemolles, il y a eu un bruit
Après cette tragédie, presque tous les habitants sont partis s'installer à Bardonnèche. La personne qui a écrit l'événement a perdu cette nuit-là ses deux parents.
Lyon après-guerre
J'ai quitté Chambéry pour Lyon où m'attendait ma tante Philippine, une soeur de maman. Elle avait une grande chambre, la presse avait dit que tous les locaux inoccupés qui n'avaient pas été détruits par les bombardements seraient réquisitionnés.
 |
Elle avait tellement peur de perdre son pied-à-terre qu'elle m'a écrit de venir à Lyon pour l'occuper, ce que j'ai fait début mai 1946.
Je ne me rappelle plus exactement le nombre marches à monter, environ cent-soixante, pour arriver au cinquième étage du 5 petite rue des Feuillants, sur les pentes de la Croix-Rousse. Une porte qui fermait mal, deux grandes fenêtres aux vitres détruites, pas d'eau, pas d'électricité, une cuisinière à deux feux, mais pas de gaz. Ma tante est repartie dormir chez ses patrons pour reprendre son travail de bonne heure le lendemain matin. Je me suis retrouvée seule, sans lumière. |
Une voisine m'a demandé qui j'étais. « Je suis une nièce de Mademoiselle Tournour ». « Ah, elle est gentille mais on ne la voit pas souvent. Rentrez-donc Mademoiselle ! ». Curieuse, elle voulait tout savoir. En fin de visite, elle m'a dit qu'au premier étage, il y avait une manufacture de lingerie qui cherchait une repasseuse. « Vous pouvez y aller de ma part. ». J'y suis allée tout de suite et j'ai été prise à l'essai... et ils m'ont gardée !
En juillet, le patron m'a demandé si je partais en vacances car la manufacture fermait quinze jours. Non, je ne partais pas. « Vous aimez les enfants ? ». « Bien sûr ! ». « Si vous voulez venir à la campagne avec ma famille, vous pourriez vous occuper de mes cinq enfants, ils ont entre quatre et douze ans. ». « Oh oui, je veux bien ! ». Rendez-vous est pris pour le lendemain, me voilà dans une grande voiture, et après une trentaine de kilomètres, devant un château, le château du Montellier !
Une femme de chambre me demande de la suivre avec mon bagage et me conduit au pigeonnier, dans une petite chambre propre, toute blanche, des meubles en bois blanc massif, un petit lit avec un très bon matelas et la vue sur un grand parc ! C'est de ma fenêtre que l'on voyait le plus loin !

A Beaulard, j'avais appris à chanter la messe et dans la forêt, on chantait tout ce qui nous passait par la tête et il m'est arrivé de chanter la Messe des Anges en latin que je savais par cœur. Un soir, à dîner, Lucienne, l'ainée des filles, est venue en cuisine
Le lendemain et ensuite, j'ai remarqué un changement à mon égard. Bonjour Mademoiselle, bonjour Elvire, des sourires, et même le grand-père, directeur du Crédit Lyonnais de la Rue de la République à Lyon, me regardait avec moins d'indifférence. Il faut dire que tous étaient très bigots !
Pendant que j'étais à la campagne, à la manufacture, les ouvrières fabriquaient la lingerie à la machine, et à mon retour, début octobre, il y en avait un tas considérable à repasser, à ranger dans les boîtes correspondantes, prêtes pour la vente.
Le jeune homme timide
Pour la Toussaint, ma voisine m'a dit de demander à mon patron s'il pouvait l'emmener en voiture jusqu'au Montellier car elle voulait aller au cimetière sur la tombe de ses parents. Il était d'accord de m'emmener aussi, si je le voulais. Avec la voiture, il nous a emmenées jusqu'à la porte de la maison qu'elle avait hérité de ses parents. Le soir nous avons dormi ensemble et le lendemain, après la cérémonie, nous avons fait la route à pied depuis Le Montellier jusqu'à Pérouges. Dix kilomètres n'étaient pas pour me faire peur ! J'ai trouvé le vieux Pérouges très beau. Elle me dit : « J'ai une tante qui y habite, on va lui dire bonjour ». Arrivées elle me présente. « Elvire, une voisine, elle travaille pour Richard du Montellier, nous venons te dire bonjour, et nous prendrons le train pour Lyon ». La tante nous a servi un très bon goûter, des crêpes avec du fromage frais et à ce goûter assistait également un beau garçon, le fils de la maison. Tous les dimanches soir, il reprenait le train pour Lyon où il travaillait à l'Arsenal, à l'atelier de mécanique. Il était très intimidé, il ne parlait
Dans le train du retour, il y avait beaucoup de monde, nous n'avons pas parlé beaucoup mais quand il m'a quittée, il m'a dit : « On se reverra ».
Joseph venait rarement chez sa cousine Joséphine, mais après ce jour-là, il venait bien souvent la trouver. Elle venait me chercher et nous passions la soirée ensemble avec le mari de Joséphine, Lucien, un savoyard qui avait trouvé du travail à Lyon comme facteur. Il avait fait la guerre de 14-18 où il avait été gazé, ne pouvait plus faire de travaux pénibles et l'administration lui a donné ce travail. Quand je ne travaillais pas le dimanche, j'allais chez eux tricoter ou coudre, j'étais au chaud, la ration de charbon pour une personne ne suffisait pas pour tout le mois.
Avec leur cousin Joseph qui venait de plus en plus souvent, nous avons eu le vrai coup de foudre ! Nous nous sommes connus en Novembre et le 24 mai suivant, nous étions mariés. Novembre 1946 - Mai 1947, sept mois ! Ma tante Philippine était très heureuse, c'était le mari qu'il me fallait, bien de sa personne, gentil, travailleur, sérieux, réservé, en bonne santé, un bon Français!

 Sur la page, un bombe et deux amoureux |
 Vendanges 1947 |
Le 6 juillet 1949, un joli petit garçon nous est né,
Joël de Jo - Joseph et El - d'Elvire ! Notre bonheur était total. |
 |
| Nous avons acheté une petite moto, nous n'avions pas de garage mais la concierge nous autorisait à la mettre dans le couloir, juste à côté de la grande porte qui donnait sur la rue de Thou. Avec cette moto, nous partions tous les samedis, Joël entre nous deux, à Pérouges pour aider le papa de Joseph aux travaux de la campagne et pour faire la réserve de bois. Nous n'avions pas beaucoup de temps pour les loisirs. |  |
Francheville
Puis, dans l'année 1953, nous avons acheté un terrain pas trop loin de Lyon, à Francheville. Nous avons eu le permis de construire pour une maison selon un «plan courant». Il n'y avait que ce plan qui correspondait à nos moyens et avec la possibilité d'un prêt. Du fonctionnel mais pas de fantaisie ! Nous devions être quatre dans ce terrain, mais l'un des futurs propriétaires a dû quitter la région pour raisons de famille, un autre a préféré acheter un manteau de fourrure à sa femme avec l'argent du terrain. Le voisin Paul et nous, nous avons dû investir le double et nous serrer la ceinture, mais il était difficile de trouver un autre terrain, alors, nous avons continué le projet. L'aventure de la maison commençait !
Avec la moto, nous sommes allés, mon mari et moi, à Hauteville, commander la charpente dessinée par un architecte. Les bons bois à la bonne section, rangs pendant un an pour bien sécher et nous avons fait les deux toits en même temps, Paul et nous. Moi je ne craignais pas le vertige, j'allais de l'un a 1 autre, porter les outils, les pinces, les chevilles, les clous, le mètre, le fil à plomb, tout ce que les hommes me demandaient. Les mêmes poutres posées à
une des maisons, on recommençait à l'autre, les mêmes chevrons, les mêmes solives, etc.. Nous avons seulement fait monter les murs, les dalles et les cloisons en plâtre, tout le reste c'est nous qui l'avons réalisé. Les tuyauteries, l'électricité, les carrelages, les planchers, le chauffage central, la peinture et les papiers peints !
En octobre 1956, nous avons emménagé dans notre maison et quitté définitivement Lyon.

Notre maison toute neuve :
Joseph, sa maman, Joël, son papa, moi et la sœur de Joseph
Joseph, sa maman, Joël, son papa, moi et la sœur de Joseph
Joël a commencé l'école à Francheville-le-Haut. Monsieur et Madame Fabre étaient de très bons enseignants et Joël a toujours très bien travaillé. Entré en 6ème à dix ans au Lycée Saint-Just, notre fils ne nous a jamais donné le moindre souci pour ses écoles. Il a fait de bonnes études, bac scientifique, maths sup, maths spé, concours national chimie, reçu à une grande école, l'Ecole Supérieure de Chimie de Mulhouse, il a obtenu son diplôme d'ingénieur-docteur. Sa passion pour la photographie est née des longues heures passées dans la chambre noire à la M.J.C. de Francheville à développer ses photos. A seize ans, il était responsable du labo photo, et y passait tous ses samedis. Il est devenu un artiste reconnu pour ses nus artistiques et organise de nombreuses expositions dans le monde.
Après l'Ecole de Chimie il fit à Lyon des études de médecine avec sa jeune femme et partit s'installer avec elle comme médecin généraliste à la Réunion.

Alice, Joël et moi à l'occasion de l'exposition photos d'Oulx en Juillet 2012
A Francheville tout allait bien, nous avions notre jardin, tous nos légumes, nos fruits : prunes, fraises, framboises, cerises, pommes. La maison était agréable. Une fois à la retraite, mon mari, très bricoleur, a fait un joli atelier et la retraite se passait bien. En 1996, nous avons eu l'idée, avec Joël, d'acheter un pied-à-terre à Beaulard. Mon grand-père paternel avait une maison, dans la rue des Ecoles, qu'il avait partagée en trois pour mon père, son frère François et sa sœur Joséphine.
J'ai été obligée de prendre un géomètre qui devait faire toutes les démarches administratives et il fallait sa signature, mais en fait, il n'a rien fait, c'est moi qui ai fait toutes les démarches, lui était toujours occupé. J'ai donc dû gérer les formalités pour l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Ce qui nous a le plus gênés, c'était le change des francs en lires pour payer les entreprises. A partir de janvier 2001, l'Euro a remplacé les monnaies. Tout était plus simple, mais les travaux étaient finis pour nous, sinon quelques bricoles à terminer.

Notre maison avec son beau toit en lauzes↑
Mes enfants font le maximum pour moi mais dix mille kilomètres nous séparent ! Aujourd'hui, j'ai quatre-vingt-douze ans et bien des ennuis de santé, qui me font terriblement souffrir, mais heureusement la tête est encore là.
Je voudrais surtout donner le moins de soucis possible à mes chers enfants, je voudrais rester chez moi jusqu'à la fin, mais... le pourrai-je ??
Le temps est passé, les vieux de mon pays natal sont morts, les jeunes ont vieilli, certains sont partis aussi. L'école est fermée, le four est éteint. Dans toutes les maisons, l'eau est au robinet, les champs ne sont plus labourés, les prés ne sont plus fauchés, plus de vaches, de chevaux, de moutons, il n'y a plus de choucas dans le ciel, il n'y a plus de cardes pour carder la laine, plus de laine !
Plus rien n'est naturel ! Heureusement, il y a encore l'eau à la fontaine, le vent du Nord, du Sud, mais la vie n'est plus la même ! C'est bien ou mal ? Je ne sais pas.
La vie d'autrefois était plus dure mais plus saine ! Les gens riaient de bon cœur, la marche à pied ne faisait pas peur, maintenant il n'y a même plus de vélo, trop pénible ! On prend la voiture ou le train, mais la voiture, c'est mieux. Elle pollue, on s'intoxique mais elle nous laisse devant la porte, c'est moins fatigant !
La radio, la télévision, nous donnent toutes les nouvelles dans notre fauteuil, le téléphone nous évite d'aller trouver un ami, mais ça ne remplace pas la présence et la
Mais où est le bonheur ?
Francheville, le 20 avril 2014 - Pâques
Elvire Pelerin
Elvire Pelerin
| LES CHEVEUX BLANCS Dans le pays ou je suis née Les cheveux blancs sont des valeurs Les cheveux blancs sont un honneur Les cheveux blancs sont fierté Dans le pays d'où je viens Les cheveux blancs sont patience Les cheveux blancs sont tolérance Les cheveux blancs sont pleins d'entrain Ils ont vécu joies et chagrins Et ont gagné toutes les guerres Ils me consolent pour hier Ils m'encouragent pour demain Sur la terre de mes ancêtres Quittant le paraître ils ont pu être Ils ont su faire don de tendresse Tout en léguant leur sagesse Ces cheveux blancs qui étaient noirs, Me racontent toute mon histoire. Ils me rappellent mon devoir Et entretiennent mon espoir Au pays de mon enfance Les cheveux blancs sont des câlins Qui savent me tendre la main Quand ils me sentent en souffrance Dans le pays ou j'ai grandi Ces cheveux blancs me font envie C'est un grand présent de la vie C'est la chance qui nous sourit |
Ces cheveux blancs sont mes racines Ils ont toujours comblé l'abîme Qui voulait nous séparer Quand la colère nous opposait. Les cheveux blancs de mon grand-père Malgré cet aspect sévère Me sont toujours d'un grand secours Car ces cheveux blancs là sont amour Chers cheveux blancs de père et mère Je sais maintenant ce que je vous dois J'accepte aujourd'hui tout l'envers Devant la grandeur de l'endroit. J'espère qu'un jour sur ma tête Comme tous les Vieux de la planète. J'aurai beaucoup de cheveux blancs Que m'envieront mes descendants. Alice 
|
